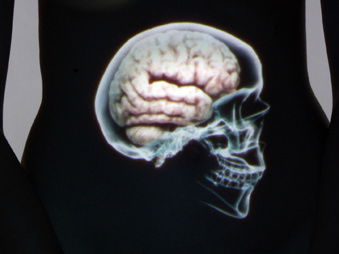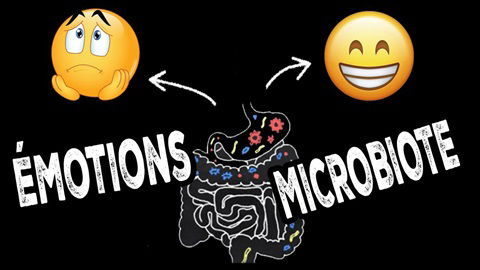Les indices d'une implication des bactéries intestinales dans certaines maladies mentales s'accumulent. Faut-il soigner celles-ci par le ventre plutôt que par le cerveau ?
Notre tube digestif abrite une communauté microbienne comptant près de cent mille milliards de bactéries. Composé d'environ un millier d'espèces différentes, ce « microbiote intestinal » représente une diversité génétique énorme. On le considère aujourd'hui comme un véritable organe, situé à l'interface des aliments ingérés, qu'il contribue à digérer, et de la muqueuse intestinale. Il échange des signaux moléculaires avec cette dernière, ce qui lui permet in finede communiquer avec tout l'organisme. Au cours des dix dernières années, le séquençage du génome du microbiote (le métagénome) et l'analyse des espèces chimiques qu'il produit ont progressé grâce à diverses avancées techniques. Les chercheurs ont alors accumulé des preuves d'un lien entre la physiologie de l'hôte et le microbiote, qui va jusqu'à influencer le cerveau.
On a ainsi montré que certaines maladies étaient associées à des déséquilibres du microbiote, nommés dysbioses. L'encéphalopathie hépatique est l'une d'elles. Ce syndrome neuropsychiatrique se manifeste, entre autres, par de l'anxiété et des troubles de l'humeur et de la cognition. Il est principalement causé par une insuffisance hépatique (un dysfonctionnement du foie), mais il se caractérise aussi par une composition particulière du microbiote intestinal. Ce dernier produit en quantité excessive certaines substances, tel l'ammoniac, qui ne sont plus détoxifiées par le foie et s'accumulent de façon anormale dans la circulation sanguine et le cerveau.
L'utilisation d'antibiotiques ou de prébiotiques (des composés alimentaires non digestibles qui stimulent l'activité ou la croissance des bactéries intestinales) permet de diminuer les troubles neuropsychiatriques, signe d'une influence du microbiote sur le cerveau. Cette influence s'exerce-t-elle même dans un organisme sain ? Joue-t-elle un rôle dans d'autres maladies du système nerveux central ? Par quels mécanismes les bactéries intestinales peuvent-elles agir à distance sur le cerveau ? C'est à ce type de questions qu'un nombre croissant de chercheurs tentent de répondre depuis quelques années.
Les biologistes ont mis au point deux stratégies pour étudier l'effet du microbiote intestinal sur le cerveau. La première se fonde sur des animaux dits axéniques, qui sont privés de ce microbiote ; on observe les dysfonctionnements de leur organisme et on tente de les corriger par l'inoculation d'un microbiote. La seconde stratégie, appliquée à la fois chez l'homme et chez l'animal, consiste à moduler le microbiote intestinal par l'administration d'antibiotiques, de prébiotiques et de probiotiques (des bactéries ou des levures qui ont divers effets sur le microbiote, dont elles corrigent les déséquilibres dans certains cas), puis à analyser les conséquences.
Chez les rongeurs axéniques, le principal dysfonctionnement est une hypersensibilité au stress , constatée pour la première fois en 2004 par Nobuyuki Sudo, de l'Université de Kyūshū, au Japon, et ses collègues. Après avoir immobilisé des souris axéniques et des souris normales pendant une heure, les chercheurs ont montré que la concentration sanguine de corticostérone, une hormone liée au stress, était doublée chez les animaux dépourvus de microbiote. Par la suite, ce résultat a été confirmé à plusieurs reprises, d'abord chez la souris à l'Université McMaster au Canada et à l'Université de Cork en Irlande, puis chez le rat par notre équipe à l'Inra.
Le microbiote semble donc avoir un effet modérateur sur la réponse au stress. Peut-on obtenir un effet déstressant en le modulant ? Deux études réalisées en 2011 et 2012 par Javier Bravo, de l'Université de Cork, et ses collègues, et par Afifa Ait-Belgnaoui, de l'Inra, le suggèrent. Les chercheurs ont montré que l'administration de bactéries probiotiques à des rats et des souris atténue la libération de corticostérone provoquée par des situations stressantes.
Au niveau comportemental, la réponse au stress se traduit par divers effets : combat, fuite, comportements anxieux... Ces derniers ont été les plus étudiés, à l'aide de tests consistant à analyser la réaction de rongeurs placés dans des situations anxiogènes : forte luminosité, espace ouvert non protégé… Au cours de ces tests, la réponse comportementale des rongeurs axéniques diffère presque toujours de celle de leurs congénères. Les comportements anxieux peuvent être augmentés ou atténués selon les rongeurs et les tests utilisés (ces comportements dépendent de multiples paramètres et ne varient pas forcément de la même façon que la concentration de corticostérone), de sorte que le sens de la régulation exercée par le microbiote fait débat. En revanche, l'inoculation d'un microbiote aux animaux axéniques conduit toujours à une normalisation du comportement anxieux, ce qui confirme l'existence de cette régulation.
Une influence sur les émotions
De façon générale, le microbiote influencerait la réactivité émotionnelle, comme le suggère une étude réalisée en 2013 par Kirsten Tillisch, de l'Université de Californie à Los Angeles, et ses collègues. Des femmes ayant consommé durant un mois un produit laitier enrichi en probiotiques accordaient moins d'attention à des stimulus émotionnels négatifs, tels des visages exprimant la peur ou l'anxiété ; en outre, l'imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM) a révélé que cette consommation modifiait l'activité de structures cérébrales impliquées dans la perception sensorielle et le contrôle des émotions.
En 2013, l'équipe de Timothy Dinan, à l'Université de Cork, a montré que l'absence de microbiote détériore le comportement social. Par exemple, dans un test de sociabilité utilisant un dispositif à trois chambres, les souris axéniques préfèrent la chambre vide à celle hébergeant un congénère, et vont plus volontiers vers une souris qu'elles connaissent que vers une inconnue. Ce comportement traduit une motivation sociale moindre et une peur de la nouveauté. L'inoculation d'un microbiote rétablit chez ces souris un comportement social comparable à celui de souris normales. Nous avons abouti à la même conclusion chez le rat en 2014 : des rats axéniques mis en présence d'un congénère inconnu engagent moins de contacts sociaux que des animaux normaux.
Les mécanismes impliqués restent à préciser, mais diverses modifications chimiques du cerveau ont été observées. Les bactéries intestinales influent notamment sur la concentration cérébrale de plusieurs neurotransmetteurs (les substances assurant la communication entre neurones) tels que la dopamine, la sérotonine ou la noradrénaline, et sur celle de neurotrophines (des protéines favorisant la croissance et la survie des neurones). Ainsi, chez les animaux axéniques ou qui ont consommé des probiotiques, les concentrations de ces substances sont modifiées dans plusieurs régions du cerveau. La façon dont le microbiote influe sur ces concentrations est encore inconnue.
Un lien entre microbiote et autisme
Ces études révèlent l'influence du microbiote sur le cerveau et les effets néfastes de ses déséquilibres. Certaines pathologies neurodéveloppementales ou psychiatriques humaines seraient-elles liées à de tels déséquilibres ? Nous avons vu que pour un syndrome neuropsychiatrique complexe, l'encéphalopathie hépatique, ce lien est établi. Un faisceau d'indices suggère une implication du microbiote dans d'autres pathologies, telles que les maladies du spectre de l'autisme et les troubles de l'humeur .
Ainsi, plusieurs travaux ont révélé que le microbiote intestinal d'enfants autistes présentait des différences avec celui d'enfants témoins. L'activité métabolique du microbiote était également particulière, comme l'ont révélé les métabolites retrouvés dans les matières fécales et dans l'urine. Précisons cependant que dans ces études, beaucoup d'enfants autistes avaient reçu de façon répétée dans leur jeune âge des antibiotiques à large spectre, ou suivaient un régime alimentaire spécifique en raison de troubles gastro-intestinaux fréquents. Ces deux éléments ont pu causer un déséquilibre du microbiote intestinal sans rapport avec leur pathologie.
Néanmoins, l'hypothèse d'un rôle du microbiote dans l'autisme est accréditée par des résultats publiées en 2013 et obtenus par l'équipe de Sarkis Mazmanian, de l'Institut de technologie de Californie (Caltech), à Pasadena, sur un modèle de souris imitant les anomalies comportementales de la maladie : comportement asocial et stéréotypé, anxiété, déficit de vocalisations (assimilable à des troubles de la communication)… Le microbiote de ces souris présentait des particularités de composition et d'activité métabolique qui évoquaient celles des enfants autistes. Les chercheurs ont ensuite montré que la modification du microbiote intestinal peut améliorer les anomalies comportementales de ces souris : les symptômes de celles traitées avec une souche bactérienne de l'espèce Bacteroides fragilis se sont atténués, tandis que leur microbiote se normalisait.
Quelques résultats commencent à être obtenus chez l'homme. En 2000, les équipes de Richard Sandler, de l'Hôpital pour enfants Rush, à Chicago, et de Sidney Finegold, de l'Université de Californie à Los Angeles, ont mené un essai clinique chez un petit groupe d'enfants âgés de quatre à sept ans et atteints d'autisme régressif (une forme d'autisme apparaissant tardivement, après l'âge de 18 mois). Les enfants ont reçu de la vancomycine, un antibiotique ciblant certains groupes de bactéries intestinales dont la composition est différente chez les personnes autistes (et chez les modèles de souris autistes). Leurs anomalies comportementales se sont alors atténuées et leur capacité à s'exprimer s'est améliorée. Ces résultats étayent l'hypothèse d'une implication du microbiote intestinal dans l'autisme. De nombreux autres essais cliniques seront cependant nécessaires pour la confirmer.
Un antibiotique qui soigne la dépression ?
Qu'en est-il des troubles de l'humeur, telle la dépression ? Plusieurs travaux ont montré que la composition du microbiote intestinal est bouleversée chez des rongeurs présentant un comportement de type dépressif, provoqué soit par une séparation de leur mère dans la petite enfance, soit par la mise hors service de leur système olfactif à l'âge adulte (par l'intermédiaire d'une opération chirurgicale au cerveau). Chez l'homme, une équipe de la Faculté de médecine d'Izumo, au Japon, a découvert en 2012 qu'un antibiotique, la minocycline, atténue les symptômes dépressifs, tels que la tristesse, les insomnies, l'anxiété, etc. Malheureusement, aucune analyse du microbiote intestinal n'a été réalisée dans cette étude, de sorte qu'on ignore si l'effet bénéfique est dû à une modification du microbiote ou aux propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices de la minocycline (qui limite la mort des neurones et le stress oxydant).
D'autres essais cliniques ont montré que la consommation de bactéries probiotiques atténue le niveau d'anxiété et améliore l'humeur ou l'état émotionnel d'individus à tendance dépressive. Cet effet favorable des probiotiques a aussi été observé sur des modèles animaux de dépression. Par exemple, l'administration du probiotique Bifidobacterium infantis à des rats rendus « dépressifs » par une séparation précoce de leur mère améliore leur comportement. Parallèlement, plusieurs paramètres perturbés par la séparation redeviennent normaux, tels que le fonctionnement du système immunitaire et la concentration de noradrénaline (un neurotransmetteur dont le déficit serait une des causes de la dépression) dans le tronc cérébral, où elle est synthétisée.
Là encore, de nombreux essais cliniques devront être réalisés pour établir l'efficacité des probiotiques dans le traitement de la dépression. Ces études préliminaires ont tout de même conduit l'équipe de T. Dinan à proposer de définir une nouvelle classe de probiotiques, les psychobiotiques : il s'agirait de micro-organismes vivants qui améliorent les symptômes de patients souffrant d'une maladie psychiatrique, en produisant dans leur intestin des molécules susceptibles d'interagir avec le cerveau.
Des ponts entre intestin et cerveau
Les mécanismes qui lient ces maladies aux bactéries intestinales restent à élucider, mais on connaît plusieurs moyens par lesquels le microbiote influe sur le cerveau. Deux catégories de molécules seraient en cause : d'une part, celles produites par l'activité métabolique des bactéries et libérées dans l'intestin (il s'agit par exemple d'acides gras issus d'un processus de fermentation) ; d'autre part, celles qui constituent l'enveloppe des bactéries, leurs cils ou leurs flagelles (des prolongements cellulaires dotés de fonctions sensorielles ou motrices). L'action de ces molécules sur le cerveau peut être directe ou indirecte. Dans le premier cas, elles passent dans le sang ou activent les voies nerveuses innervant la muqueuse intestinale. Dans le second, elles provoquent la libération par la muqueuse de certains composés, qui à leur tour passent dans le sang ou activent les voies nerveuses .
Les bactéries intestinales libèrent dans l'intestin des molécules très variées, susceptibles d'être transportées par le sang jusqu'au cerveau. Un déséquilibre du microbiote, provoqué par exemple par une infection ou un traitement antibiotique, aboutit parfois à une production excessive de certains de ces composés, qui deviennent alors toxiques pour l'organisme. C'est le cas dans l'encéphalopathie hépatique, où l'ammoniac et les acides gras à chaîne courte fabriqués par le microbiote concourent, avec d'autres composés, au dysfonctionnement cérébral. En 2010, l'équipe de Derrick MacFabe, de l'Université de Western Ontario, au Canada, a reproduit chez le rat des troubles comportementaux assimilables à ceux de l'autisme en injectant dans le cerveau des acides gras à chaîne courte d'origine bactérienne, l'acétate et le propionate.
Certaines des molécules synthétisées par les bactéries sont identiques aux neurotransmetteurs humains. Activent-elles les terminaisons nerveuses de la muqueuse intestinale ? On l'ignore, mais l'implication des voies nerveuses dans la communication entre le microbiote et le cerveau est avérée. Les bactéries intestinales agissent sur le système nerveux entérique, un ensemble de neurones situés dans la paroi intestinale et connectés au cerveau par l'intermédiaire du nerf vague. Ainsi, chez la souris, plusieurs expériences ont montré que l'administration de bactéries probiotiques diminue l'excitabilité d'une population de ces neurones, les neurones sensoriels entériques. Deux études réalisées en 2011 par les équipes de Premysl Bercik, de l'Université McMaster, au Canada, et de J. Bravo ont aussi révélé, toujours chez la souris, qu'une section du nerf vague empêchait les probiotiques d'atténuer un comportement anxieux.
Les mécanismes moléculaires par lesquels les bactéries intestinales agissent sur les terminaisons nerveuses entériques restent à préciser. Certains seraient en tout cas indirects : selon plusieurs études, le microbiote module l'activité des cellules endocrines de la muqueuse intestinale. Ces cellules sécrètent des petites protéines qui influent sur les neurones, les neuropeptides. Les neuropeptides modulent par exemple la satiété ou l'anxiété, agissant localement sur le système entérique, mais aussi à distance sur le cerveau grâce à leur passage dans le sang.
Les cellules endocrines de l'intestin présentent de fins prolongements, qui sont en contact direct avec les bactéries. En culture cellulaire, l'activation de récepteurs situés sur ces prolongements par des molécules de l'enveloppe bactérienne provoque la sécrétion de cholécystokinine, un neuropeptide. D'autres travaux montrent que l'administration d'un mélange de probiotiques et de prébiotiques à des rats augmente la concentration sanguine d'un autre neuropeptide, le neuropeptide Y.
Le microbiote module d'autres types d'activités dans les cellules endocrines de l'intestin. Chez les rongeurs, la consommation d'une souche probiotique de Lactobacillus acidophilus augmente le nombre de récepteurs sensibles aux opiacés et aux cannabinoïdes à la surface de ces cellules. Cela provoque une baisse de sensibilité à la douleur, témoin d'un effet sur le cerveau dont les mécanismes sont à éclaircir.
Outre les systèmes nerveux et endocriniens, les bactéries intestinales font aussi réagir les cellules immunitaires qui peuplent la muqueuse. Dans certains cas de déséquilibre du microbiote ou d'invasion par des bactéries pathogènes, ces cellules produisent des molécules, les cytokines, qui entraînent des inflammations. Ces cytokines atteignent parfois le cerveau, où elles déclenchent une seconde production de cytokines pro-inflammatoires, cette fois par les cellules dites microgliales. Il s'ensuit une inflammation du tissu nerveux, qui s'accompagne de perturbations du comportement, telles qu'une perte d'intérêt pour l'environnement physique et social, une perte d'appétit ou des altérations cognitives.
Inversement, des études chez le rat ont montré que certaines bactéries probiotiques entraînent une baisse de la concentration de cytokines pro-inflammatoires dans le sang et un ralentissement de la dégradation des neurotransmetteurs dans le cortex cérébral. Toujours chez le rat, le probiotique Lactobacillus farciminis atténue l'augmentation des concentrations cérébrales de cytokines pro-inflammatoires consécutive à un stress. Ce probiotique limiterait l'accroissement de la perméabilité intestinale entraînée d'ordinaire par le stress, et donc l'accessibilité des composés bactériens aux cellules immunitaires productrices de cytokines.
Notre connaissance du rôle du microbiote intestinal dans la physiopathologie des maladies neurodéveloppementales et psychiatriques est encore sommaire. Les progrès passeront par une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels ce microbiote dialogue avec le cerveau. Un accent particulier devra être mis sur l'étude de la période néonatale, cruciale tant pour l'établissement du microbiote intestinal que pour la maturation du cerveau. Nous l'avons vu, des rongeurs dépourvus de microbiote ont une sensibilité exacerbée au stress, qui peut être atténuée par l'inoculation d'un microbiote ; cependant, cette intervention n'est efficace que si elle a lieu peu après la naissance. À l'âge adulte, la normalisation de la sensibilité au stress n'est plus possible, suggérant que le microbiote agit sur le développement de certaines structures cérébrales.
Par ailleurs, les analyses du microbiote intestinal de patients souffrant de maladies neurodéveloppementales ou psychiatriques sont aujourd'hui trop peu nombreuses. Leur développement, permis par l'essor des techniques de séquençage du métagénome, sera déterminant pour mieux connaître la physiopathologie de ces maladies et pour concevoir de nouvelles thérapies fondées sur la correction des déséquilibres du microbiote. Les travaux effectués chez les rongeurs avec des probiotiques et des prébiotiques sont encourageants. Il pourrait aussi être intéressant de transplanter des microbiotes, comme le suggère une étude originale conduite à l'Université McMaster au Canada : en 2011, P. Bercik et ses collègues sont parvenus à atténuer le niveau d'anxiété de souris en remplaçant leur microbiote par celui de congénères moins anxieuses.
Sylvie RABOT
est chargée de recherche à l'institut Micalis (UMR 1319), au centre Inra de Jouy-en-Josas.